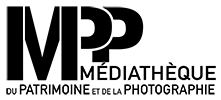Création du prix RAAMI-Recherche en histoire de l’Art et Archéologie des Mondes de l’Islam

Prix RAAMI
Date limite de candidature : 16 janvier 2026
RÈGLEMENT
Article 1 – Objet du prix
Le Comité Français d’Histoire de l’Art (CFHA) et le Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans (GIS MOMM, UAR 2999 Études aréales) en collaboration avec la Fondation Inalco, organisent chaque année le prix RAAMI – Recherche en histoire de l’Art et Archéologie des Mondes de l’Islam. Le nom Raami, dérivé de l’arabe (râmi, « celui qui lance ») et du persan (« l’archer »), est également l’un des noms donnés au Sagittaire dans la tradition arabe. Il évoque une figure animée par une soif insatiable de connaissance et d’expérience. En astrologie arabe, il symbolise plus largement la quête de sagesse.
Ce concours a pour objet de distinguer chaque année une thèse contribuant par sa qualité à une meilleure connaissance et compréhension des productions et des pratiques artistiques des mondes de l’Islam, de ses débuts au tournant du XXIe siècle.
À travers ce prix, la communauté scientifique entend distinguer et valoriser les travaux les plus innovants dans ce domaine, issus de la jeune recherche menée au sein des établissements français.
Article 2 – Montant du prix
Le CFHA attribue annuellement 1500€ (mille cinq cent euros) pour ce prix. Ce montant initial pourra être complété par la contribution financière d’autres partenaires. Pour l’année 2026, la Fondation Inalco abondera ce prix à hauteur de 1500€ (mille cinq cent euros). Le montant total du prix en 2026 représentera la somme de 3000 euros (trois mille euros).
Le montant attribué en complément est fixé annuellement par le conseil scientifique du GIS MOMM et par ses partenaires pour ce prix.
Article 3 – Conditions pour candidater et dossier
Avoir soutenu une thèse en français ou en anglais dans un établissement universitaire français, portant sur un sujet relevant du champ couvert par le présent prix. Les thèses doivent être soutenues au cours des trois années civiles précédant la remise du prix.
Une thèse peut être proposée deux fois au prix RAAMI.
Composition du dossier :
Un exemplaire électronique de la thèse dans sa version de soutenance au format PDF ;
Un exemplaire du rapport du jury de soutenance au format PDF ;
Une copie du diplôme de doctorat.
Un CV de la personne candidate, indiquant notamment ses activités depuis la soutenance et ses projets d’avenir.
Les dates et modalités de dépôt de dossier seront indiquées chaque année dans l’appel à prix.
Les dossiers incomplets ou arrivés hors-délai ne seront pas examinés.
Article 4 – Organisation des jurys et procédure de sélection
L’appel à candidatures pour le prix RAAMI est publié en même temps que des prix de thèse Islam, Moyen-Orient et mondes musulmans (IMOMM) du GIS MOMM et de l’Institut d’études de l’Islam et les Sociétés du Monde Musulman (IISMM, UAR2500 CNRS/EHESS).
Le jury pluridisciplinaire des prix IMOMM procède à une première évaluation en interne des candidatures et soumet à un jury spécifique les candidatures admissibles (selon les critères des prix IMOMM : dossiers de candidatures complets, respect du périmètre du prix, apport et originalité de la thèse [caractère novateur du sujet, du terrain, des sources et du propos], pertinence de la méthodologie et de l’argumentation [traitement des sources ou du terrain, connaissance de l’historiographie et de la bibliographie, outillage théorique]). Le jury spécifique peut avoir accès à l’ensemble des candidatures déposées ; il peut exceptionnellement décider de réévaluer un dossier écarté.
Le jury spécifique se compose de 4 membres spécialistes du domaine, désignés à parts égales par les directions du GIS MOMM et du CFHA et d’un membre représentant chaque direction de ces deux institutions. Les membres du jury sont nommés pour trois ans, renouvelable une fois.
Un·e président·e est choisi·e au sein des membres de ce jury ; il ou elle est désigné·e par la direction du CFHA en alternance avec la direction du GIS MOMM, pour une durée d’un an.
Si elles le souhaitent, les directions du GIS MOMM et du CFHA sont représentées de droit au sein du jury, à raison d’un·e représentant·e par institution.
La composition des membres du jury est publique.
Le GIS MOMM, le CFHA et la Fondation Inalco contribuent à l’organisation matérielle du travail du jury et à l’organisation de la cérémonie de remise du prix.
Les membres du jury procèdent à la répartition des dossiers et peuvent faire appel à des évaluateurs externes si nécessaire, en veillant à éviter tout conflit d’intérêt. Ils organisent en toute indépendance leurs travaux et délibérations. Ils n’ont pas à motiver leurs décisions. Il ne peut être fait appel de leurs décisions.
Les prix sont attribués à la majorité des voix par les membres du jury, chacun disposant d’une voix. En cas d’égalité, la voix du ou de la président·e du jury est prépondérante.
Les membres du jury qui ont dirigé les travaux d’un ou d’un·e candidat·e ne prennent pas part à l’évaluation des dossiers en question.
Le jury peut exceptionnellement désigner deux lauréats ex-aequo, ou signaler une ou deux thèses dans son rapport.
Après examen des candidatures, le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix s’il estime que les dossiers présentés ne répondent pas de manière satisfaisante à l’objet du prix ni aux critères énoncés.
Après délibération, la personne présidant le jury rédigera un rapport, indiquant le nombre de candidatures et expliquant les raisons du choix de la thèse primée.
Article 5 – Critères d’attribution du prix
L’attribution des prix se fait en fonction des critères suivants : apport et originalité, méthodologie mise en œuvre, qualité d’argumentation et d’écriture, portée de la thèse.
Article 6 – Obligations du lauréat
En acceptant un prix de thèse RAAMI, chaque lauréat·e s’engage :
– à signer l’autorisation d’utilisation d’image et de cession de droit en annexe du présent règlement permettant les actions de communication ;
– à mentionner de manière valorisante le prix dont il a bénéficié en cas de publication de tout ou partie de sa thèse intervenant après l’attribution du prix, a minima sous la forme suivante : « Cette thèse a reçu le prix RAAMI du GIS MOMM financé et soutenu par le Comité français d’histoire de l’art [ajouter les noms des autres institutions dotant le prix si relevant] en [année]. »
Article 7- Communication du règlement
Publié sur le site du GIS MOMM et du CFHA, le règlement peut être obtenu par voie électronique par toute personne qui en fait la demande, en écrivant à : gismommcontact@services.cnrs.fr
Article 8 – Informatique et libertés
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les postulants disposent d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant.
Les participant·es souhaitant exercer leur droit peuvent le faire en écrivant à :
– Par voie postale :
GIS Moyen-Orient et mondes musulmans
Prix de thèse
UAR 2999 Études aréales
5 cours des Humanités, Campus Condorcet bât. Sud
93300 Aubervilliers
– Par voie électronique : gismomm-contact@services.cnrs.fr
Article 9 – Acceptation du règlement
La participation au prix implique l’acceptation du présent règlement.